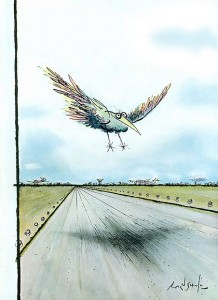Il affectionnait les chats et les escargots, qu’il croquait d’un trait élégant et caustique, au piquant jamais acerbe. Le dessinateur anglais Ronald Searle, 91 ans, s’est éteint le 30 décembre 2011 à Draguignan (Var), où il vivait depuis plus d’un demi siècle. De lui, on connaît surtout les matous souvent matois, ou les scènes satiriques publiées dans Le Monde, The New Yorker ou The International Herald Tribune.
Les Britanniques, eux, ont été particulièrement marqués par la série St Trinian’s, qui met en scène dès 1948 des écolières malveillantes et incontrôlables, qui sirotent de l’alcool et manient les armes comme qui rigole. L’engouement pour ces diablesses est tel que des films sont tournés – ils donneront lieu à des remakes au mitan des années 2000. L’artiste est pourtant lassé de ces petits monstres adulés, et tentera de les tuer sur papier en 1952 (il lance une bombe atomique sur leur école), sans succès.
Né à Cambridge en 1920, Ronald Searle grandit dans une famille modeste, qui encourage son don pour le dessin. A 15 ans, il vend ses premiers croquis au Cambridge Daily News, finançant ainsi ses cours du soir. Volontairement engagé dans le génie militaire, il est envoyé à Singapour, capturé en 1941 par les Japonais et forcé de travailler à la construction de la ligne de chemin de fer Birmanie-Thaïlande, où les hommes meurent à tour de bras. Malgré la dysenterie et la malaria, il survit pendant quatre ans, ne lâchant jamais son crayon. « Tout le monde avait un livre avec une page blanche, racontait-il en 2005 dans un entretien à la BBC. On me donnait ces papiers, et je dessinais dessus. Cela me permettait de tout enregistrer, de me transformer en caméra. »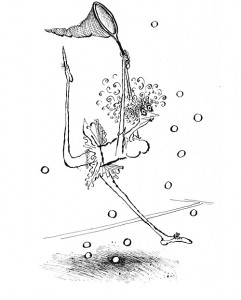
De retour à la vie civile, il s’intéresse à l’actualité, couvrant pour Life Magazine la campagne présidentielle de JFK en 1960 ou le procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem l’année suivante. Influencé par le travail de l’Allemand George Grosz, et lui-même influence revendiquée de nombreux artistes – dont Matt Groening, le créateur des Simpson –, Ronald Searle avait le sentiment de n’avoir jamais quitté la prison construite par les Japonais. Une situation qu’il semblait avoir acceptée, affirmant que, « pour créer, il faut être isolé ».
Laurence Le Saux (Télérama)
Le 5 janvier 2012
Ronald Searle, l’élégance piquante du cartooniste
Filed under Régal de la presse
Mon Far breton créole

Pour un grand plat en terre, en fer ou en verre, style plat à lasagne bien beurré.
240 g de farine
200 g de sucre semoule
6 œufs
1 l de lait entier
Rhum vieux
500 g de pruneaux dénoyautés
Sel 1 belle pincée
60 g de beurre
Cuisson 35 à 40 min
« Exceptionnel » m’a-t-on-dit en goûtant ce savoureux dessert.
Les compliments s’ajoutent au plaisir de régaler ces gourmands !
Préchauffez le four th 7/ 210 °
Dans un saladier mélangez farine, sucre et sel. Ajoutez œufs, un par un, remuez au fouet au fur et à mesure afin d’éviter les grumeaux. Pendant ce temps, faites fondre le beurre. Très important de bien battre à chaque ajout d’ingrédient pour obtenir une belle pâte homogène. Une fois tous les œufs ajoutés, mettre le rhum, alors là, je tourne la tête, et de très mauvaise foi : « Oups, mince…, ça a coulé … » . Donc j’en mets beaucoup pour qu’on sente sa présence dans le far. Ensuite, j’ajoute le lait, s’il n’est pas entier, ce n’est pas grave, doucement, pour permettre une bonne incorporation et un mélange parfait. Et enfin le beurre refroidi, c’est mieux à la fin car sinon, le mélange tourne.
Voilà c’est fini. Enfin presque.
Dans le plat préalablement « embeurré », disposez les pruneaux dénoyautés (plus difficiles à trouver, mais impératifs pour une dégustation exquise), puis la pâte.
Enfournez le tout au milieu du four à 210 ° pendant 15 à 20 min. Le far est toujours liquide (c’est-à-dire pas cuit) au milieu, après cette première cuisson, remontez-le et poursuivez-la pendant 15 min à four plus chaud (jusqu’à 250 °), le far se recouvre alors d’une robe couleur auburn voir pruneau… ça tombe bigrement bien. Surveillez bien pour ne pas passer au mode grillé-carbonisé.
Le plus dur : attendre qu’il soit tiède avant de le déguster.
Hédiard, Fauchon et autres grandes épiceries
 Poivres et sels
Poivres et sels
Ici, il n’y a pas de rayons mais des comptoirs, dont les couleurs et les odeurs fleurent bon l’exotisme. Voyage à l’intérieur d’épiceries fines de Paris.
Paris, place de la Madeleine, numéro 21 : Hédiard 1854, ancien Comptoir des colonies et de l’Algérie. A l’intérieur de la boutique règne un désordre ordonné. Le décor boisé, subtilement vintage, évite la nostalgie facile. Impression d’un kaléidoscope bousculé d’ombres et de lumières. Ivresse d’un patchwork de senteurs provocantes qui font des promesses inconsidérées. Ici, il n’y a pas de rayons mais des « comptoirs », comme jadis dans les anciens établissements coloniaux. Abondance : le comptoir des thés présente les boîtes écarlates de 240 variétés sous leur couvercle en bonnet de mandarin ; celui des épices, 51 épices en vrac et 70 autres conditionnées. Des pyramides de sels – dont un rose de l’Himalaya – évoquent un souk lointain. Une charrette de marchand des quatre saisons trône, rappelant les débuts de Ferdinand Hédiard, place des Victoires. C’est dans sa boutique, installée place de la Madeleine à partir de 1870, que furent révélés aux Parisiens les plus improbables produits exotiques, des épices oubliées, des fruits de contre-saison et d’autres qu’on n’avait encore jamais vus sous nos latitudes.

Les épices ont toujours été un signe extérieur de richesse. Le mot vient du latin species, qui a donné espèces… Au Moyen Age, le poivre était une monnaie. Pour remercier, on donnait un pot de poivre : l’origine du pot-de-vin ! A l’époque de Marco Polo, d’autres épices aussi chères ont suivi, faisant la fortune de Venise et des marchands arabes du Moyen-Orient. Pour les conquérir, les Compagnies « des Indes » – britannique, hollandaise, portugaise et française – se sont livré de furieuses batailles en mer. Les marchands qui négociaient ces denrées étaient appelés épiciers, voire apothicaires, les épices étant appréciées pour leurs vertus médicinales. D’ignobles falsifications virent le jour : de la crotte de chien mélangée à du poivre ! Au ?XVIIIe siècle, les épiciers élargissent leur commerce à toutes sortes de comestibles exotiques. Le grand gastronome Grimod de La Reynière évoque, parmi ceux du Palais-Royal, le fameux Corcellet, dont l’ultime descendant, Paul, a disparu il y a peu. Chez lui, on trouvait des pattes d’ours, du boa fumé, de la trompe d’éléphant… Pour une chronique de l’émission de Jacques Martin Le Petit Rapporteur, il m’avait préparé des sauterelles grillées enrobées de chocolat : leur distribution au public du studio fut la cause d’une panique assez réjouissante.
Depuis la disparition de Corcellet, Hédiard reste l’héritier le plus fidèle de la grande tradition des épiceries fines. Les marchandises y sont présentées à l’ancienne, posées sur de rudes sacs de jute : 18 huiles (avec en vedette l’extravierge de Toscane), 25 confitures, 25 moutardes en déclinaisons et superpositions affolantes. On peine à lire les étiquettes. Discrètement, au bon moment, un vendeur propose son aide : « Si je peux faire quelque chose pour vous, faites-moi signe. » Un labyrinthe nous mène à la haute verrière qui coiffe l’espace où sont assemblés et brûlés les cafés. Au choix, une trentaine d’arabicas en bal les ouvertes (de 25 à 200 euros le kilo). En vedette : le Coffea laurina cher à Louis XV et le « mélange Hédiard » (Brésil-Ethiopie-Burundi). Plus loin, dans un chai en cage vitrée, se dévoilent plus de 1 000 références de vins, du modeste Riesling (10 euros) à la riche Romanée-Conti 1985 (21 780 euros). Sur un grand escalier double sont présentés des alcools fameux mais peu raisonnables, certains millésimes remontant au XIXe siècle. On y trouve même un bas-armagnac 1932, le plus mauvais d’entre eux : un oubli du sommelier, par ailleurs excellent.
Ailleurs, légumes et fruits font un jeté battu, en étal de fraîcheurs. Suivent en conjonction 24 fruits confits (dont l’ananas confit de Maurice et de La Réunion), 24 pâtes de fruits, 26 parfums de fruits glacés. Plus inattendu, un foie gras entier mi-cuit à la mélasse de grenade et baies de canneberge (160 euros le kilo). Je n’ai pas remarqué si l’on poivre le Brin d’amour, un fromage corse de brebis en retour de terroir – à chacun son exotisme.
Un ascenseur d’avant-garde nous hisse au restaurant. Bois polis et ventilos retour d’Orient : l’atmosphère y est plus British Empire que colonies françaises. La carte est bien pensée. Maquereau-gelée wasabi, jambon Trevélez, sole meunière sont intéressants. Dattes et marmelade de citrons sont bienvenues sur le bar. Faisselles et confitures nous ramènent à l’enfance. Le tout accompagné par un bon pomerol au verre avec, en prime, une vue panoramique sur la Madeleine.

Sur la même place, en face, Fauchon, l’éternel rival. Après guerre, c’était à qui trouverait au-delà des tropiques ce que l’autre n’avait pas déniché. On se querellait autour du poivre vert, de la mangue, de l’avocat… Face à un Hédiard bourgeois et familial, Fauchon se montre plus snob avec ses directeurs brillants et fastes. Tandis que le premier joue la tradition tout en se projetant prudemment à l’extérieur, le second mondialise à tout-va, exploitant au maximum son nom quitte à le banaliser. A preuve la luxueuse, chère et froide décoration du Fauchon d’aujourd’hui, tirée au trait, balisée au carré, en forme de déjà-vu : on pourrait y vendre n’importe quoi. L’accueil est professionnel, prompt et souriant, mais stressé. A ne pas acheter, on ressent comme un bizarre sous-entendu : circulez, il n’y a rien à voir. On regrette une communication pédante : le rituel du thé est « rythmé par une série d’émotions et de perceptions très sensuelles qui arrivent les unes à la suite des autres » ; le chocolat prétend à « la rupture intelligente » et à « l’alternative permanente » ; le fromage incarne « une démarche engagée en for me de manifeste pour une offre éclairée » ; les desserts jouent la « transposition d’imaginaires non culinaires ». Et j’en passe ! Les chocolats n’en sont pas moins d’exception, les pâtisseries braves, la confiserie est maligne, un des foies gras (celui à la fraise) superbe, les saumons fumés sont remarquables, et le chef de cuisine est un grand professionnel.
Comme Hédiard, Fauchon a son restaurant, Le Café. Une décoration flashy de murs-miroirs décalés y clame son clinquant, et les rebondis mous des canapés argentés sont accueillants à défaut d’être classe. Le personnel, souriant, est un peu stressé, et la carte fait de l’humour : « Fish and chic… sel fou » (drôle, non ?). Des déceptions : un jambon de Parme dix-huit mois rance, un mille-feuille à la vanille hésitant. De bonnes surprises : le saumon fumé d’Ecosse exceptionnel, la sole meunière très en forme, et un beau bar à saumons et caviars. La maison a fait du chemin depuis qu’Auguste Fauchon a installé, vers 1885, sa carriole de fruits et légumes sur la place.

Depuis 1978, Hédiard et Fauchon ont un concurrent de taille, La Grande Epicerie de Paris, qui va bien au-delà de la seule épicerie fi ne et s’inscrirait plutôt par ses dimensions en héritière de l’énorme maison Félix Potin. Depuis la création, en 1923, à l’intérieur du Bon Marché, d’une minuscule surface alimentaire vouée aux conserves et aux thés, l’actuelle épicerie a pris ses aises : 3 000 mètres carrés de surface, 25 000 références de produits, bien plus qu’Hédiard et Fauchon ré unis ! Gigantesque halle de l’alimentation générale, elle est impressionnante. Elle délivre souvent du bien bon : boulangerie, jambons blancs, conserves du monde entier, thés, charcuteries, légumes, pâtes, condiments, légumes secs ou vins. Moins exaltants sont les prêts-à-manger, la boucherie et les fruits, trop polis. Tels Hédiard et Fauchon, La Grande Epicerie a son restaurant, une belle double terrasse-jardin, ouverte ou couverte. Dans cet « italo-snack » civilisé, le service est jeune et joyeux, mais la direction navrante et la cuisine inégale : charcuterie de Tosca ne honorable ; pâtes au basilic de qualité mais un peu trop cuites ; tiramisu digne d’addiction. Le spectacle de dames en rupture de shopping et de confidences vaut bien qu’on recommande une bière.
Dernière étape du voyage chez le magicien des épices, Olivier Roellinger, immense cuisinier à Cancale, installé depuis peu à Paris. Raide d’une échelle de cale. Lumière de lanternes au-dessus d’une étagère chargée de boîtes en fer-blanc aux douze vanilles (chères à Baudelaire). Sensation entre roulis et tangage : à ôter le couvercle de l’une d’elles, l’étagère a frémi d’un léger va-et-vient. Comme si leur traversée des océans continuait. Remontée à la boutique, voisine des bureaux de Voyageurs du monde. Senteurs aux exotismes compliqués à débrouiller, enivrant à se « poivrez », comme écrivait Rabelais. Rayonnages en sages alignements de centaines de petits flacons étiquetés rouges de « poudres d’ épi ces » (de 7,70 à 8,70 euros), de la Défendue (anis vert, gingembre, cannelle et épices diverses) pour les salades de fruits à la Marine (fenouil, ajowan, coriandre, ail et divers) pour les poissons iodés. Les sels (à partir de 6 euros), comme la Fleur de Lune (fleur de sel, vanille, cumbavas), et les huiles aux aromates (à partir de 7,70 euros), comme la Muscade (huile de pépins de raisins, amande, muscade, macis), ne sont pas en reste. La boutique tient du cabinet de curiosités : ici, un coffre que l’on imagine d’un pirate de Zanzibar ; là, constituée de clous de girofle, l’insolite maquette d’un boutre. Le magicien Roellinger y embarquerait-il par les nuits sans lune vers ses îles aux épices ?
Comptoirs de luxe
Hédiard (depuis 1854) 21, place de la Madeleine, Paris VIIIe Tél. : 01-43-12-88-98.
Fauchon (depuis 1886) 26, place de la Madeleine, Paris VIIIe. 01-70-39-38-00.
La Grande Epicerie de Paris – Le Bon Marché (depuis 1978) 38, rue de Sèvres, Paris VIIe. 01-44-39-81-00.
L’Epicerie de Bruno (« l’homme aux 160 épices ») 30, rue Tiquetonne, Paris IIe. 01-53-40-87-33.
Izrael 30, rue François-Miron, Paris IVe. 01-42-72-66-23.
Roellinger 51 bis, rue Sainte- Anne, Paris IIe. 01-42-60-46-88. 1, rue Duguesclin, Cancale. 02-99-89-64-76. 12, rue Saint-Vincent, Saint-Malo. 06-18-80-44-10.
Arosteguy (depuis 1875) 5, avenue Victor-Hugo, Biarritz. 05-59-24-00-52.
Arax 24, rue d’Aubagne, Marseille. 04-91-33-94-89.
Philippe Couderc
Filed under Régal de la presse